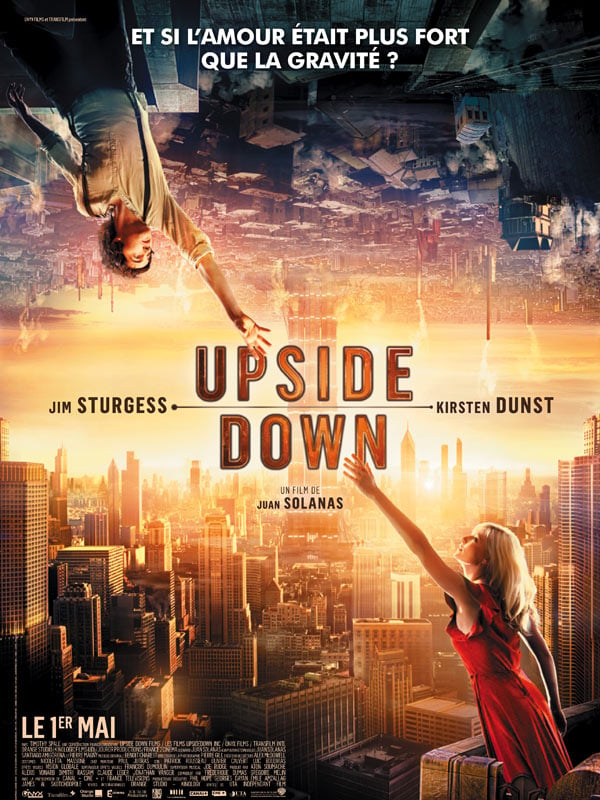2h22 - Sortie le 22 mai 2013
Un film de Paolo Sorrentino avec Toni Servillo, Carlo Verdone, Sabrina Ferilli
Jep Gambardella – un bel homme au charme irrésistible malgré les premiers signes de la vieillesse – jouit des mondanités de Rome. Il est de toutes les soirées et de toutes les fêtes, son esprit fait merveille et sa compagnie recherchée. Journaliste à succès, séducteur impénitent, il a écrit dans sa jeunesse un roman qui lui a valu un prix littéraire et une réputation d’écrivain frustré : il cache son désarroi derrière une attitude cynique et désabusée qui l’amène à poser sur le monde un regard d’une amère lucidité. Sur la terrasse de son appartement romain qui domine le Colisée, il donne des fêtes où se met à nu "l’appareil humain" – c’est le titre de son roman – et se joue la comédie du néant. Revenu de tout, Jep rêve parfois de se remettre à écrire, traversé par les souvenirs d’un amour de jeunesse auquel il se raccroche, mais y parviendra-t-il ? Surmontera-t-il son profond dégoût de lui-même et des autres dans une ville dont l’aveuglante beauté a quelque chose de paralysant ?
COMPÉTITION OFFICIELLE DU FESTIVAL DE CANNES 2013
La Moyenne des Ours : 4,3/5
Le point de vue de Pépite : 3,5/5
Le dernier film de Paolo Sorrentino est beau, intéressant, pertinent, contemplatif est pas chiant !
On suit avec délectation cette "nouvelle" incarnation de la Dolce Vita, le comédien-génie Toni Servillo (qui a personnellement gagné toutes les palmes et prix d'interprétation dans mon coeur de cinéphile !). Servillo incarne le film, le complète et l'enrichit. Et enrichir un film déjà si beau, c'est fort. La Grande Bellezza est une ode à la vie, à l'art, à l'amour, à la vieillesse. La mise en scène éclatée, suave et sensuelle de Paolo Sorrentino est vraiment riche - les mouvements de grue, de travelling, etc., sont encore mieux maîtrisés que dans This Must Be The Place, et toujours signifiants !
On peut trouver le film un peu long, certes, mais les anecdotes et traits de certains personnages secondaires qui pourraient être de trop ne le sont pas vraiment car ils sont pertinents et intéressants.
Il est compliqué de se faire vraiment un avis objectif sur ce film, tant c'est un film dans lequel on rentre et on voyage, avec délectation, pendant 2h22. Un bijou qui laisse pensif et rêveur à sa sortie.
Un soleil de plomb, des fontaines et un touriste japonais, qui s’écroule après une ultime photo, sous les regards cruels des antiques statues de Rome. Voilà l’introduction haute en symboles de "La Grande Bellezza", film-fleuve d’une beauté renversante qui distille au compte-goutte sa puissance formelle.
L’on suit ici Jep Gambardella (Tony Servillo impérial), ersatz moderne du Marcello Rubini de "La Dolce Vita", mais ersatz plus observateur et paradoxalement plus actif, qui erre de superficialités en supercheries, dans une Rome tiraillée entre la splendeur de son patrimoine et les bassesses de son oligarchie.
"La Grande Bellezza", c’est l’anti "Gatsby". On retrouve d’ailleurs le motif d’une puissance supérieure qui surveille de loin les bruits de la ville. Dans "Gatsby", ce motif se traduit par un vieux panneau publicitaire bleu (absolument non exploité), ici, c’est une gigantesque enseigne lumineuse Martini, première preuve de la terrible ironie qui parcourt de long en large le film.
Ainsi, Paolo Sorrentino prends un malin plaisir à tirer avec intelligence sur les aspects du monde moderne, que ce soit "l’art" contemporain, à travers deux scènes qui s’opposent (cette performeuse idiote qui fonce dans des murs et cette gamine criarde, qui finit par faire émerger son talent du chaos de départ), la Religion (encore une fois, par opposition : ce futur Pape croyant pour un sou et cette Sainte qui a perdu ses dents en luttant contre la misère et qui refuse les interviews), ou encore cette folle croyance que le talent est démocratique (ces actrices ratées qui veulent écrire du Proust).
Jep Gambardella, qui a cessé de créer pour commenter, est un cynique lucide dont l’existence futile est guidée par la superficialité. Au cours de ses ballades dans Rome, il expose ses tactiques pour ne jamais perdre la face en public, pire chose qui pourrait arriver en société. C’est un personnage fort et doux, dont le vernis social se craquelle au fur et à mesure que le film avance (dans cette scène d’enterrement démente où, malgré la foule, aucun « ami » ne se lève pour porter le cercueil du défunt) et que son seul vrai ami rend, lui aussi, son masque pour retourner vers ses racines.
Et quand ce dernier empereur des nuits romaines se décide à remettre les choses à leur place, on ne peut qu’adhérer à son propos avec délectation. Il y a d’ailleurs beaucoup de scènes bavardes (le film penche alors vers "La Terrasse" d’Ettore Scola) mais que pourrait-on y supprimer ? Car Sorrentino développe une vraie délicatesse vis à vis de ses personnages, qu’il ne juge pas, mais dont il confronte simplement les idéologies, tout comme il confronte l’homme et l’Histoire. Parfois, on rit de ces pantins qui vont jusqu’au bout de leur bêtise, on rit de cette Sainte qui monte les escaliers à genou, avant de se taire et d’admirer sa ferveur et sa simplicité.
La mise en scène est parsemée de mouvements de grue, comme dans son précédent film "This must be the place", qui pouvait largement s'en passer. Sauf qu’ici, ces effets prennent toute leur ampleur tant ils rejoignent le rapport à Dieu (ou en tout cas aux esprits supérieurs) omniprésent dans "La Grande Bellezza", et ce jusque dans ce majestueux générique final sur le Tibre, résumé parfait de l'essence du film.
Portée par une bande son magique (Sorrentino a pioché dans le répertoire de Zbigniew Preisner pour ses moments les plus forts), "La Grande Bellezza" est un choc qui n’en a pas l’air, un constat lucide et intelligent, plein d’espoir et d’émotion. Tout comme un monument, il semble anodin, mais plus on s’en approche, plus on en discerne l'intelligence et la portée (aussi bien du propos que de l’héritage italien que le film porte). Touchant et magistral.